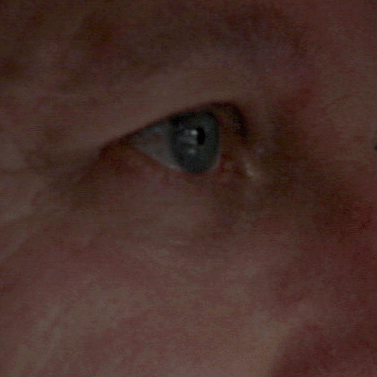La solitude en partage
* Nicolas Philibert, le regard d’un cinéaste, Bibliothèque Publique d’Information, Centre Pompidou, novembre 2009
Le documentaire, dit-on, a le vent en poupe : visibilité grandissante, influence plus que jamais féconde sur la fiction, coups d’éclat retentissants. La reconnaissance due aux documentaristes au titre d’auteurs, c’est-à-dire dépositaires d’une vision qui fait œuvre, ne s’en distribue pas moins avec parcimonie. Dans le sillage des grands anciens dont la mort commence à clairsemer les rangs (Joris Ivens, Johan van der Keuken, Jean Rouch), rares sont les nouvelles figures qui parviennent à conquérir ce statut. Michael Moore aux Etats-Unis, Wang Bing en Chine, aux antipodes géographiques et esthétiques l’un de l’autre, sont de ceux-là. En France, à côté d’une pléiade de talents (Jean-Louis Comolli, Claire Simon, Henri-François Imbert…), deux noms paraissent s’imposer dans la durée au plus grand nombre : Raymond Depardon et Nicolas Philibert.
Leur parcours a beaucoup en commun : filiation avec le cinéma direct, effacement du commentaire, radiographie des institutions, intérêt pour la marginalité. On peut ajouter qu’ils inaugurent chacun leur carrière avec un film qui témoigne de manière si aiguë du basculement social et politique d’une époque qu’on les escamote durablement (50,81% en 1974 pour le premier, La Voix de son maître en 1978 pour le second). Et encore que la distribution régulière de leur œuvre en salle contribuera notablement au rayonnement du genre. Leur divergence est toutefois plus instructive. L’œuvre de Depardon, du moins pour ce qui concerne sa part documentaire, procède assez clairement de l’influence conjuguée de Richard Leacock et Frederick Wiseman, et se veut en prise frontale avec les quatre coudées de la réalité, dont elle tire en dernière instance sa seule légitimation. Depardon, photographe de formation et chasseur à l’œil vif, ne perd en d’autres termes jamais de vue son sujet. Celle de Philibert, qui regarde plutôt du côté de Pierre Perrault, s’intéresse davantage à ce qui transforme la réalité, lui résiste, la brouille. Le sujet ne cesse de s’y échapper par mille chemins de traverse, avant d’être recueilli, comme par inadvertance, au terme d’une battue menée la fleur au fusil. Tous ses films portent ainsi une part discrète, mais à fort coefficient opératoire, d’imaginaire, de fiction, d’humour, voire de fantastique.
L’homme est né à Nancy en 1951, passe une partie de sa jeunesse à Grenoble, se cherche du côté de la philosophie, avant de s’égarer définitivement au cinéma en compagnie de René Allio, réalisateur libertaire et humaniste, dont il devient le stagiaire à l’arraché puis l’assistant. Dans la queue de comète révolutionnaire des années soixante-dix, il lance sa carrière comme un pavé socratique dans la mare patronale (La Voix de son maître, coréalisé avec Gérard Mordillat), disparaît aussitôt après pour se livrer à diverses activités (publication de livres, apprentissage du langage des sourds, projet de fiction inabouti…), revient à la mi-temps des années quatre-vingts avec une série sportive de longue haleine pour la télévision (notamment aux côtés de l’alpiniste Christophe Profit), avant d’entamer au début des années quatre-vingt dix l’escalade de ses propres sommets dans La Ville Louvre, film à partir duquel s’élabore l’essentiel de son œuvre. L’un dans l’autre, cela ne fait jamais que sept longs métrages en trente ans de carrière, menée pour sa plus grande partie dans le cadre de la même société de production, Les films d’ici, et en son sein avec le même producteur depuis 1990, Serge Lalou.
L’un des éléments constitutifs de cette œuvre, par un trait qui l’apparente déjà à une dramaturgie, consiste à s’attacher à une réalité sujette à une mutation, une rupture, un changement de structure ou d’identité. Le passage du capitalisme familial au capitalisme financier à travers les visages et la rhétorique du nouveau patronat (La Voix de son maître), la spectacularisation de l’alpinisme par un jeune athlète qui en bouleverse les règles (Trilogie pour un homme seul, 1987), la transformation du Musée du Louvre, en pleins travaux de rénovation, saisie de l’intérieur (La Ville Louvre, 1990), les préparatifs de réouverture au public de la grande galerie zoologique du Muséum d’histoire naturelle (Un animal, des animaux, 1994), la préparation d’une pièce de théâtre par les patients d’une institution psychiatrique (La Moindre des choses, 1996), le défi lancé aux élèves du Théâtre national de Strasbourg de monter leur propre spectacle (Qui sait ?, 1998).
Mais Philibert s’intéresse plus encore, et ce sous l’angle à la fois trivial et précieux de sa mise en œuvre, à ce que ce processus implique pour les hommes qu’à son résultat proprement dit. C’est évident dans Qui sait ?, où l’on comprend très vite que la proposition de mise en scène d’un spectacle, qui n’aura jamais lieu, relève d’une maïeutique destinée à soulever d’autres lièvres (le rapport entre imaginaire et réel, l’idéal collectif, la citoyenneté…) dont l’agrégation constituera le film. La méthode est généralisable partout ailleurs, de manière plus ou moins implicite. Au Louvre, l’intéressent moins les œuvres que les soins qu’une armée de petites mains leur prodigue, moins le prestige de l’art que la manière, tantôt tragique tantôt burlesque, dont il nous hante (Belphégor) et nous requiert (Sisyphe) à travers les impératifs de sa conservation. Au Muséum d’histoire naturelle, il ne se penche sur les techniques de la taxidermie que pour mieux mettre en scène une fantasmagorie à la Franju, où l’homme est incessamment inquiété par l’animal qu’il subjugue. A Laborde, ce n’est pas tant la tenue finale de la pièce jouée par les fous qui le retient que ce que sa préparation suggère, jusqu’au vertige, de réversibilité entre raison et folie.
Quant aux films dont le sujet échappe à cette réalité en chantier, c’est en vertu même de la permanence, voire de l’anachronisme présumé qu’ils mettent en scène, qu’ils questionnent en retour les mutations de la société. C’est ainsi que le langage des sourds, historiquement en butte à l’hostilité, la moquerie et l’indifférence, est rendu à sa prodigieuse expressivité poétique, qui semble renvoyer les entendants à leur propre infirmité (Le Pays des sourds, 1992) ; que le maître et les élèves d’une classe unique du Puy de Dôme offrent un magnifique contre-exemple humaniste et pédagogique à la dégradation des idéaux de l’école républicaine (Être et avoir, 2002) ; que de petits paysans normands, jadis acteurs d’un film évoquant un cas de folie meurtrière survenu dans leur région au dix-neuvième siècle (Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère de René Allio, 1975), reconduisent sous la caméra de Philibert une sorte d’archéologie séculaire de l’aliénation et de la révolte.
Deux traits saillants reviennent par ailleurs dans tous ces films. Le premier est d’ordre philosophique et méthodologique : donner la part belle à l’imprévu, suivre les pistes proposées par le hasard, saisir la chance de perdre le fil (mais de gagner le film) en s’ouvrant à la distraction de la rencontre avec autrui, autrement dit à l’apport substantiellement créatif de sa participation. Ceci, qui pourrait être la définition idéale du documentaire, caractérise aussi bien l’aventure du cinéma moderne. Il s’ensuit, dans le cinéma de Philibert, l’insistance d’une interrogation sur l’acte même de la représentation. Il y a dans tous ses films sinon la mise en abyme d’un spectacle, à tout le moins une référence forte à l’art de la mise en scène. Patrons encouragés à choisir librement leur mode d’apparition à l’écran (La Voix de son maître), alpiniste employé comme doublure d’un acteur (La Face nord du camembert, 1985) ou réalisant un exploit sous l’œil omniprésent des médias (Trilogie pour un homme seul, 1987), analogie entre langage des sourds et grammaire cinématographique (Le Pays des sourds), fous et paysans pris dans le miroitement d’une fiction qui les altère et les révèle tout à la fois (La Moindre des choses, Retour en Normandie), on pourrait multiplier les exemples.
Le point important qui en résulte est la porosité qui s’établit entre réalité et imaginaire, l’attention portée au processus qui permet de passer insensiblement d’un état à l’autre. Deux conséquences fortes. D’abord, l’art de nous rendre proche le lointain par la naturalisation cinématographique d’espèces, de groupes ou de communautés marginalisés (animaux, sourds, fous, artistes, paysans…). Ensuite, l’utilisation constante de cet art comme une sorte de recherche appliquée sur lui-même et sur le monde. Pour envisager la question au plus large, on pourrait dire que le cinéma de Nicolas Philibert ne met en scène qu’une seule chose : la transformation du chaos en organisation, du désordre en ordre, de la nuit à la lumière. Condition artistique et condition sociale y sont aux prises avec les mêmes impératifs, les mêmes apories, les mêmes espoirs, le même destin, la même question : comment vivre ensemble ? Plus précisément encore, comment fabriquer du collectif avec de l’individuel, de la viabilité communautaire avec de l’irréductibilité pulsionnelle ? C’est à ce défi, pour ne pas dire à cette utopie, que se confronte le cinéaste comme le citoyen, le spectateur comme le politique.
In fine, c’est aussi face à lui-même, face à sa propre histoire et à ses propres valeurs, que Nicolas Philibert mène ce débat de film en film. Formé, humainement et cinématographiquement, à une époque où certains idéaux de justice sociale et d’engagement collectif avaient encore droit de séjour, accomplissant son œuvre durant une période qui les frappera de caducité, le réalisateur n’a de cesse d’en éprouver les fondements. Quelque chose qui serait presque de l’ordre du déterminisme inconscient traverse ainsi son œuvre : c’est le rapport à la gratuité de l’échange, à la beauté du geste, au partage soustrait à la logique marchande. Deux exemples, pris en ses extrémités. La Voix de son maître, comme il le faisait justement remarquer, est un film où jamais le mot « profit » n’est prononcé par ces nouveaux patrons dont la raison d’être est pourtant d’en produire à n’importe quel prix. Sept ans plus tard, La Face nord du Camembert inaugure le retour du cinéaste sur la scène cinématographique, dans un registre qu’on pourrait supposer très éloigné : l’escalade. Mais il se trouve que le héros de ce film se nomme Christophe Profit, et que Nicolas Philibert commence à ses côtés une série de films dont un des principaux enjeux est la perte de l’aura romantique liée à l’alpinisme au profit de sa médiatisation et d’une logique de capitalisation de l’exploit.
Anecdote dira-t-on et psychanalyse à la petite semaine. Peut-être, mais ça serait faire peu de cas du procès retentissant, étourdissant, déclenché par le succès colossal et inattendu du film Être et avoir. Le maître d’école, Georges Lopez, en a pris l’initiative, attaquant le film pour contrefaçon, et réclamant de conséquents droits d’auteur. Ce détournement, au pied de la lettre, d’un credo artistique fondé sur le partage est à la fois un coup de Trafalgar dans l’histoire du documentaire et une atteinte à la probité du cinéaste dont on peut imaginer la cruauté. C’est aussi, plus essentiellement, un signe des temps, contre la fatalité desquels l’œuvre de Philibert n’a justement cessé de lutter. L’amère ironie de l’histoire est que ce film est celui qui se rapproche le plus dans l’œuvre du cinéaste d’une sorte d’utopie réalisée. Faut-il considérer comme un hasard le fait qu’on veuille lui en faire payer, réellement ou symboliquement, le succès ?
Disons les choses, puisque l’œuvre de Philibert, gage de bonne santé, a aussi ses détracteurs : Être et avoir a cristallisé comme principal grief porté contre son cinéma celui d’un certain irénisme. Retour en Normandie, réalisé quatre ans plus tard et splendide échec commercial, prouverait à lui seul combien ce soupçon est inconsidéré. A travers l’histoire d’un jeune paysan parricide, du procès qui lui fut intenté, du livre de Michel Foucault et du film de René Allio qui en furent tirés, à travers les retrouvailles avec les acteurs non professionnels de ce film dont il fut l’assistant réalisateur, Nicolas Philibert, dans l’ombre portée de Être et avoir, en revient aux engagements et aux valeurs qui ont fondé sa vocation de cinéaste. Il dessine surtout à ciel ouvert une manière d’autoportrait qui nous le révèle comme jamais. On y pressent un gouffre intime, fait de folie menaçante et d’irrémédiable solitude, au-dessus duquel l’œuvre tisse une toile fragile et divagante, ravaude un réseau de solidarités désemparées. Cet appel aux vertus du lien collectif comme seule planche de salut résonne évidemment très fort dans le monde qui est le nôtre. Il suggère par ailleurs que chaque film de Nicolas Philibert, aussi apparemment aimable soit-il, revient de loin.