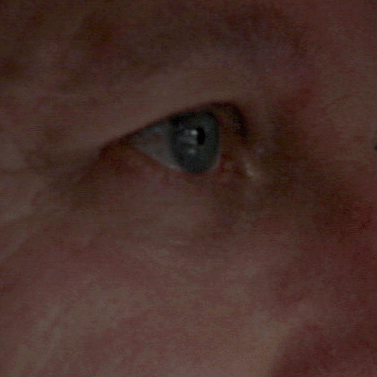Je n’ai jamais décidé de devenir documentariste…
Texte paru dans Nicolas Philibert, le regard d’un cinéaste, Bibliothèque Publique d’Information, Centre Pompidou, novembre 2009
Je n’ai jamais décidé de devenir documentariste, c’est-à-dire de camper une fois pour toutes à l’intérieur d’un espace donné. D’ailleurs je déteste ce mot : documentariste. Il contribue à dresser une frontière autour d’un genre qui n’a jamais cessé d’évoluer et dont chacun connaît au contraire la porosité, la variabilité des tracés, les liens presque consanguins qu’il entretient avec celui qu’on lui oppose toujours, celui de la fiction. Tant il est vrai que les images sont moins fidèles au « réel » qu’aux intentions de ceux qui les produisent.
Mais il se trouve que mon premier film était un documentaire (La Voix de son maître, 1978), que le faire m’a donné envie d’en tourner un autre, puis un autre, et ainsi de suite jusqu’à aujourd’hui. C’est aussi à cette époque que j’ai découvert Wiseman, Perrault, Van der Keuken, Dindo, Kramer et quelques autres, et avec eux une diversité d’approches, de pratiques et de styles qui n’ont fait qu’aiguiser ma curiosité, le désir de me risquer à mon tour sur un continent dont j’étais encore loin d’imaginer l’étendue. Je suis donc devenu à mon tour un documentariste, et si je n’aime pas le mot, son côté étriqué, presque dissuasif, rien, ni l’énergie qu’il faut déployer pour mettre un projet en route, convaincre, surmonter ses démons, ni celle qu’il faut puiser au plus profond de soi pour se relancer après une série de refus, l’injustice d’un échec ou la démesure d’un succès, ni les menaces qui pèsent continûment sur l’existence et la circulation des œuvres les plus personnelles, les dérobades des diffuseurs, l’engorgement croissant des sorties en salles, ni les rebondissements judiciaires d’Être et avoir n’ont eu raison de mon appétit.
Je ne suis pas seul. Bien d’autres cinéastes partagent cet élan. Ce que nous faisons est complexe, fragile, vulnérable, mais nous sommes tenaces et endurants.
* * *
Pour chaque film, j’ai besoin de définir un cadre, le point de départ à partir duquel je pourrai commencer à construire. Ce cadre, c’est tout ce qu’on met en œuvre avec ceux qu’on veut filmer pour faire naître du désir. Naturellement, ce n’est jamais pareil d’un film à l’autre. Le psychiatre Jean Oury a une belle expression, que je cite souvent : « programmer le hasard ». Pour moi, faire un film, c’est un peu ça. Quand le tournage commence, je ne connais ni le point d’arrivée ni l’itinéraire que je vais prendre : beaucoup de choses reposent sur ce qui va surgir en cours de route, dans le travail, dans la rencontre. Pour moi, la démarche se confond avec les films eux-mêmes, c’est pourquoi il m’importe tant de pouvoir continuer à chercher le plus tard possible, jusqu’au bout.
Les films disent toujours autre chose – et d’autres choses - que ce que l’on a voulu dire, leur faire dire, ou cru avoir dit, et c’est peut-être aussi bien comme ça. Quand j’ai commencé à tourner La Moindre des choses, à la clinique psychiatrique de La Borde, j’aurais été bien en peine d’en définir le sujet. D’ailleurs, je ne le sais toujours pas vraiment. Ce n’est pas tant un film sur La Borde que grâce à La Borde et à tous ceux, pensionnaires, soignants, qui ont accepté de se prêter au jeu. J’ai longtemps hésité à le faire… Quand on a une caméra dans les mains, on exerce un pouvoir sur l’autre. Toute la question est de savoir comment ne pas en abuser. Si j’ai fini par me décider, c’est pour me confronter à ma peur, à mes scrupules, à tout ce qui me retenait. Ce qui compte c’est donc moins le sujet en tant que tel que les questions que le film va faire surgir en moi. Questions politiques, esthétiques… questions de cinéma.
* * *
Je ne prépare pas, ou disons, le moins possible. Bien trop peur de mettre le film sur des rails avant même de l’avoir commencé… et de passer à côté de l’essentiel ! Du reste, si j’en sais trop, je n’ai plus envie de faire le film. Je préfère rester au ras des choses, partir d’un non-savoir. Faire un film depuis un point de vue savant est une démarche qui m’est complètement étrangère. L’exemple de La Ville Louvre est assez éclairant : il n’y a pas un mot d’explication. Mais il a fallu tenir bon : les coproducteurs voulaient que j’écrive un commentaire. Pour Le Pays des sourds, j’avais choisi de plonger d’un seul coup dans l’étrangeté de la langue des signes, sans interprète ni aide extérieure. Au début, j’étais perdu… Je n’avais pas de repères. J’avais tenu à ne pas rencontrer les spécialistes, les médecins, les éducateurs, les psychologues. Si je l’avais fait, les sourds auraient eu l’impression d’être approchés comme des « cas », des objets d’étude.
Les films doivent garder leurs secrets, maintenir les questions ouvertes. C’est quand il y a des zones d’ombre, des ellipses, un jeu entre ce qui est montré et ce qui ne l’est pas, entre ce qu’on dit et ce qu’on laisse supposer, une part d’invisible, des personnages qui résistent, des partis-pris formels exigeants que le spectateur, déplacé, bousculé de son ordre, peut commencer à réfléchir, que son imaginaire peut se mettre en route. Quand tout est lisse, familier, transparent, apprivoisé, rassurant, sans aspérité ni accrocs, il n’y a pas d’histoire, c’est l’immobilité. Impression que l’inattendu favorise la pensée.
La liberté artistique ne tombe pas du ciel. J’ai toujours pensé qu’il fallait lutter, lutter sans cesse pour la conquérir, la reconquérir toujours.